
Vincentellu d'Istria
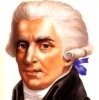
Pasquale
Paoli
Voir l'article sur l'Histoire de la Corse dans Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Corse
L'Homme
prit pied en Corse dès la période du pré-néolithique. Aux chasseurs nomades succédèrent les peuplades agro-pastorales du néolithique ancien (Filitosa,
Levie). Ce fut à la fin du néolithique que les mégalithes se multiplièrent.
L'histoire de la Corse commença véritablement avec la colonisation d'Alalia
(Aleria) aux VIe et Ve siècles av. J.-C. D'après l'historien grec Hérodote,
ce fut par cette colonie que les Phocéens firent pénétrer dans l'île les
cultes religieux et les techniques du monde méditerranéen. Néanmoins,
la présence des Phocéens puis celle des Étrusques et des Carthaginois
se limita au littoral.
Au contraire, la prise d'Aleria par les Romains, en 259 av. J.-C., marqua
le début d'une longue présence. La romanisation, puis la christianisation,
apportèrent un brassage entre autochtones, colons grecs, latins et étrangers.
Durant plusieurs siècles, l'île subit différentes dominations étrangères.
Au Ve siècle apr. J.-C., les invasions barbares (les Vandales puis les
Ostrogoths) désorganisèrent les cinq évêchés corses. Les pirates barbaresques
et les Sarrasins (VIIe au XIe siècle) débarquèrent afin de s'assurer d'autres
voies maritimes. Face à ces envahisseurs, les Corses s'installèrent à
l'intérieur des terres. Au VIIIe siècle, Pépin le Bref confirma l'attribution
de l'île au Saint-Siège. Mais devant les incursions sarrasines régulières,
la papauté concéda l'administration de la Corse à l'évêque de Pise en
1077. Après une période de paix et de prospérité, la rivalité entre Gênes
et Pise conduit le pape à attribuer aux Génois trois des six évêchés dès
1133.
Les Corses demeurèrent morcelés géographiquement et opposés socialement. Ceux de l'En deçà, situé au nord-est, soutinrent la domination génoise.
Ceux de l'Au-delà, situé au sud-ouest, luttèrent contre l'administration
de Gênes. Cette rivalité constante réduisit l'efficacité de la résistance
corse contre les conquérants, ce qui permit à Gênes de dominer l'île de
1284 à 1729.
L'exclusion des Corses dans la haute administration, les inégalités judiciaires
et la situation économique déclenchèrent une succession de jacqueries.
Les Corses s'opposèrent à Gênes, comme Sampieru Corsu (Sampiero Corso).
Voir l'article sur Sampiero Corso dans Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sampiero_Corso

Cliquez sur les vignettes
Dans ce contexte de désordre, Pasquale Paoli organisa un gouvernement de la nation Corse en 1755. La France vint au secours des génois et s'empara de l'île en 1768. Paoli s'exila pour l'Angleterre en 1769.

Bataille de Ponte Novu,
le 9 mai 1769
Lors de
la bataille de Ponte Novu,
600 Corses ont péri,
dont 250 sur le
pont, où, selon Voltaire:
"...leurs blessés se mêlèrent
parmi les morts
pour raffermir
le rempart. On trouve partout de la valeur,
mais
on ne voit de telles actions
que chez les peuples libres."
Voir l'article sur Pasquale Paoli dans Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Paoli
Pendant la
Révolution française, Paoli fut rappelé de son exil pour assumer les charges
de président du Conseil général et de commandant de la garde nationale.
Affaibli par la maladie, il rompit ses relations avec la Convention et,
sous l'influence de Pozzo di Borgo, fit appel à l'Angleterre, qui administra
la Corse entre 1794 et 1796.
Bonaparte, originaire de l'île, devenu Premier consul, engagea rapidement
l'assimilation de la Corse à la France. Cependant, l'île évolua peu. Au
cours du XIXe siècle, l'aménagement du territoire et le développement
économique de la Corse restèrent limités tandis que le banditisme et le
clientélisme perdurèrent.
La Première Guerre Mondiale fut pour la Corse une véritable saignée, qui
la priva de ses forces vives. Le pourcentage des tués par rapport à la
population fut le double du pourcentage national. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, la Corse fut le premier département français à être libéré,
en particulier grâce à l'action des Résistants (1943). Ses soldats contribuèrent
alors au débarquement de Provence.





